Une chambre à soi de Virginia Woolf, est un essai féministe qui demeure d’une vraie actualité. Le titre français est une appropriation maladroite d’une notion plus fine « a room of one’s own » qu’on peut traduire par « un lieu à soi »…Un lieu pour soi, pour y écrire, aparté hors du temps domestique auquel les femmes ont ancestralement été rattachées.

» Pourquoi un sexe est-il si prospère et l’autre si pauvre? Quel est l’effet de la pauvreté sur le roman »?

Nous sommes en 1928. Dans une salle de l’Université de Cambridge, l’autrice participe à une conférence féministe. Le sujet posé est celui de la relation entre femmes et roman, principalement dans le contexte britanique. Virginia Woolf s’éloigne assez vite du sujet et se penche sur les facteurs qui ont empêché l’accession des femmes à l’éducation, à la production littéraire et au succès.
Elle pose comme préalable à l’écriture de posséder quelque argent pour ne pas dépendre matériellement et spirituellement d’un homme et d’avoir un lieu à soi. Ce sera une chambre à soi qu’on peut fermer à clé afin de pouvoir écrire sans être dérangée par le cours de la vie domestique et familial.


» Il est néfaste d’être purement un homme ou une femme; il faut être femme-masculin ou homme-féminin.( … ) L’art de la création demande pour s’accompagner qu’ait lieu dans l’esprit une certaine collaboration entre la femme et l’homme. Un certain mariage des contraires doit être consommé. »
Une chambre à soi.
Virginia Woolf détaille les difficultés que rencontre une femme à l’époque pour voyager seule et s’ouvrir l’esprit, s’installer à la terrasse d’un café pour prendre le temps de la réflexion, accéder aux Universités anglaises traditionnelles où elle devait être accompagnée par un membre de la faculté.
L’écriture pour une femme demeure du domaine de l’activité cachée, tue. Jane Austen se cachait pour écrire et tant d’autres qui subissent la contrainte admise du processus de création. Rares sont celles qui n’ont pas été la cible de la parole masculine et critique en raison de leur sexe et non du contenu de leurs fictions. Mais elle admet un progrès : « Du temps de Shakespeare, il aurait été impensable qu’une femme écrivît les pièces de Shakespeare à l’époque de Shakespeare ».
Dans Une chambre à soi où il est peu question de ce que le titre annonce, Virginia Woolf s’adonne à l’observation critique des coutumes de la société qu’elle fréquente. Les femmes sont le sujet infini des romanciers masculins au point que les propos sexistes et misogynes passent pour vérité acquise. Son humour rappelle celui de Proust saisissant sur le vif et avec beaucoup de drôlerie, les mœurs de la noblesse décadente de son temps… Les femmes y sont réduites au silence et la pauvreté des propos auxquels elles s’autorisent pose le principe d’une aliénation consentie à la vie conjugale.
Mais, Virginia rompt avec ce modèle social et s’impose comme romancière libre dans un pays puritain. On peut s’étonner d’ailleurs de l’apparente discordance entre la silhouette presque préraphaélite de la femme qui souffre de dépression nerveuse, de bipolarité et d’anorexie et le discours revendicatif clair d’une femme déterminée.
Virginia Woolf en avant-gardiste d’un discours féministe, fait observer que les obstacles matériels rendent impossible l’éclosion d’une œuvre littéraire. L’autrice pose son insoumission irréductible comme un prérequis dont elle fait naître une œuvre majeure. D’elle, on retient l’expression d’une liberté dans la mise en place d’un style qui dit les mouvements intimes de la conscience, pris dans le cheminement d’associations de mots et d’images, de souvenirs et d’anecdotes.
Cette écriture du flux fait naturellement penser à celle de Proust. L’époque est à l’exploration des strates de la conscience et de la complexité de la psyché humaine. Il s’agit de traquer la métamorphose, l’instant précis où l’on glisse d’une idée à une autre, d’une pensée à un rêve, d’une rêve à une colère, puis à un apaisement. Il ne serait pas faux de dire en cela qu’elle devance Nathalie Sarraute qui fera porter son œuvre sur l’appréhension délicate des palpitations de l’existence, sur le flux imprévisible de la pensée, sur la condensation d’états de conscience contradictoires.


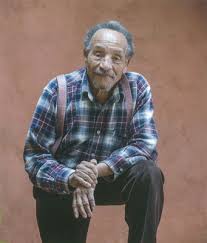


Commentaires récents