
C’est clair. La pluie et le beau temps est un sujet de conversation des plus prisés. Pas une journée, où le thème rebattu de la météo n’intervienne comme pour faire le lien entre deux individus sur un même axe de rencontre.
Mais que fait-on au juste quand on parle du temps ?
En parler permet d’être au monde, pas le monde de la pensée, mais celui des convenances qui modélisent l’individu comme individu social. La parole n’a d’autre fonction que phatique. Autrement dit, elle pose le sujet parlant comme autre à qui parler. La banalité du propos ôte à la conversation tout risque d’impliquer davantage celui qui l’énonce. On tombe souvent d’accord sur la nécessité qu’il pleuve comme sur les difficultés que la pluie occasionne à tout moment de la vie courante. On s’accorde sur le soleil mais on sait lui trouver d’évidence des inconvénients au cœur de l’été. Bref, « il n’y a plus de saison » fait consensus.
Et le sujet parlant a évité ainsi d’engager une part de lui dans la communication. Il est resté à la marge, sans nuire à la politesse élémentaire qu’est l’adresse verbale dans nos sociétés. Tout au plus, parler de la pluie et du beau temps a permis une reconnaissance de principe, celle d’appartenir à une même espèce, celle d’évoluer dans une communauté d’habitudes sociales totalement intériorisées.


Dis-moi le temps qu’il fait, je te dirai qui tu es !
Mais il peut en être tout autrement en variant l’angle de vue. Ce peut être une invitation à se livrer comme être sensible et corps traversé par des émotions.
En parlant du temps qu’il fait, je me découvre à l’autre dans mon rapport aux éléments naturels, à la saisonnalité et donc je me livre dans une intimité à peine déviée par le caractère apparemment anodin de ma parole. Sans le vouloir, nous voici à nous livrer sur nos anxiétés existentielles à composer avec les saisons, leur rythme, leurs caractéristiques qui influent sur la plus ou moins grande stabilité psychique de l’individu.
Un corps traversé par les émotions.
« Quelle grâce, ce printemps précoce ! » exprime tout à la fois un soulagement et une disponibilité au monde rendu possible par l’émergence d’une nature bourgeonnante.
L’automne a inspiré bien des artistes romantiques qui voyaient dans le retour de la saison, un miroir naturel à l’intimité de leur être mélancolique. Notre rapport à l’été tel qu’il est exprimé vaut tout autant qu’un dévoilement de soi à l’autre. Il dit notre plus ou moins grande capacité à jouir de ne rien faire , de « vaquer » au sens propre du terme. Ce faisant, la plénitude d’être simplement au monde s’énonce ou pas. Notre désir à n’être pas dans le mouvement répétitif des jours se trouve posé dans notre parole qui considère la météorologie. Bref, le ciel donne la couleur de nos idées.
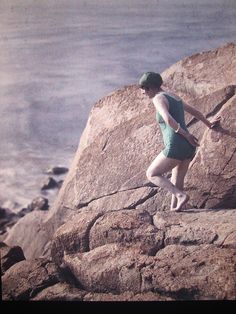


La parole comme refus de parler.
Mais encore, parler de la pluie et du beau temps peut être paradoxalement le moyen de ne pas entamer la conversation, de laisser un suspens qui équivaut à une réticence à entrer dans la danse des mots.
Parler sur le temps qu’il fait, c’est alors dire qu’on ne veut pas dire autre chose que cette limite émise a priori. Ce peut être le fait d’un manque d’éloquence, d’aisance. Ce peut être aussi le moyen d’élever un mur entre soi et l’autre de sorte que celui-ci poursuive son chemin. Nous nous en détournons. Par le sujet de la météorologie, nous disons notre altérité, notre refus à la communication. C’est une » parole blanche » dont le contenu n’est pas envahissant mais exprime implicitement le désir de demeurer dans une certaine solitude.




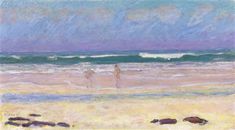

Commentaires récents