
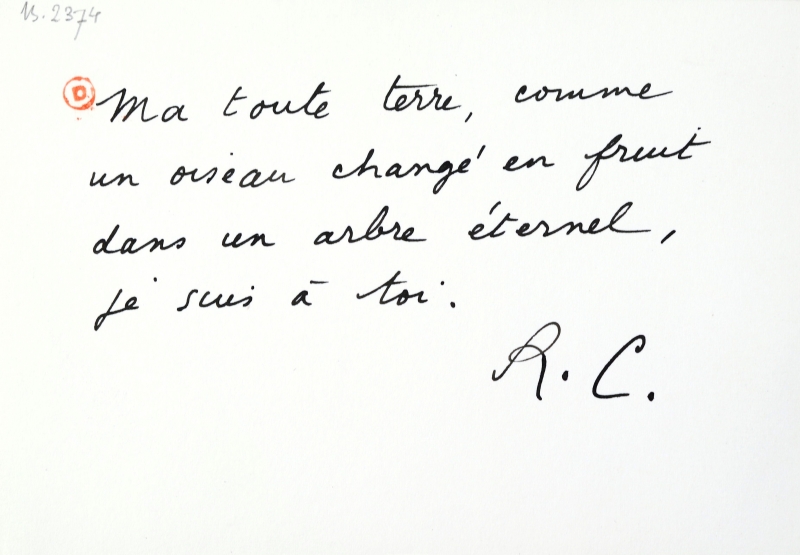
Premier jour de déconfinement.
Le bruissement de la rue initie un prudent retour à la nouveauté du jour et aux trépidations molles qui l’accompagnent aujourd’hui.
L ‘ art de l’accommodement est délicat tant ces deux mois ont été habités par des questionnements contraints et des réponses qui ont varié en fonction du temps dehors, des états psychiques mis à mal, de l’avancée du printemps, de la solitude supportée car habitée par des projets même ténus, détestée car perçue comme une privation de la liberté fondamentale de déplacement. Nous avons appris la solidarité et le contentement du moment présent, le tact peut-être, l’écoute, la patience. Nous avons subordonné nos actions à la conscience pleine de l’instant vécu. Nous nous sommes retournés sur la frénésie de notre passé proche en y percevant les limites, emplis de bonnes résolutions pour l’avenir- moins consommer, revoir notre rapport au superflu, notre rapport à la nature, consommer « local «, redonner la place au soin portée à la personne et à nos proches vulnérables et âgés.
Il est à croire que ce virus a développé chez chacun de nous une faculté à entrevoir ce que le monde pourrait être sans la course éperdue du profit et des richesses, entrevoir… seulement car il est difficile de penser que cet épisode seul permette un durable changement dans les mentalités. Michel Houellebecq à qui l’on avait demandé d’écrire une » lettre d’intérieur » ( France- Inter- lue par Augustin Trapenard ) concluait avec le cynisme clairvoyant qui le caractérise. « Le monde sera le même, en un peu pire ».
On peut prendre cette prédiction comme le fruit d’une très juste observation du monde et d’une capacité chez l’écrivain à anticiper par la fiction l’avenir proche d’une humanité dont l’équilibre est de plus en plus fragile. On peut aussi lui opposer, non par esprit de contradiction systématique mais dans un élan d’espérance et de foi en l’homme, que vaille que vaille, il y aura des sages, jeunes et inventifs, en nombre suffisant. Ils auront la force de dénoncer un système à bout de souffle, pour penser notre rapport à la nature non pas comme une prédation du vivant mais comme une co-dépendance entre l’environnement et l’humain, partie intégrante du vivant. L’épisode que nous vivons ici ne promet pas une remise en question exhaustive qui rejette définitivement le monde comme il va, mais il impulsera sans doute un sens, une sagesse pratique et individuelle dont les Etats devront se faire progressivement le relais pour retrouver leur légitimité perdue.





Commentaires récents