
Nicolas de Staël a ceci de particulier pour moi qu’il provoque immanquablement une profonde émotion renouvelée à chaque toile quel qu’en puisse être le sujet. Les couleurs y sont matière.
De ses désirs successifs et contradictoires , de son retour final à la figuration, on retient surtout l’élan d’un artiste vers une toujours plus grande liberté. L’histoire du peintre s’inscrit dans celle du matériel et de l’immatériel, lequel avait déjà inspiré les impressionnistes en leur temps. Mais dans le dépassement de la transparence comme signe pictural, Nicolas de Staël fait place au foisonnement de la pâte, à la densité de la matière.


La couche devient relief et la couleur, le sujet même de la peinture.
Si la peinture classique utilisait une matière discrète, les objets de la peinture contemporaine répandent « leur substance sous nos yeux » selon les mots du philosophe Maurice Merleau Ponty dans La prose du monde. Nicolas de Staël, quant à lui, livre un combat avec la matière. La pâte rugueuse apparaît comme une réalité presque charnelle, définie par la marque de l’instrument à peindre. Le couteau remplace bientôt le pinceau. La matière ainsi s’alourdit, et les valeurs chromatiques s’intensifient, valeurs envisagées pour elles-mêmes et sans considération mimétique.
Peindre est un corps à corps avec la toile.
Pour Nicolas de Staël, peindre est une dépense physique, un engagement de tout l’être.
Ce combat qu’il livre avec la toile est rendue perceptible dans les hachures et formes géométriques étroitement imbriquées les unes dans les autres. Sa peinture est chargée d’ardeur, de colère, d’inquiétude aussi alors que le mouvement de la main modèle une impulsion vive du corps vers la toile. C’est une peinture profonde et peut-être un peu sombre mais en aucun cas triste. Les rapports de tons sont savamment étudiés , maîtrisés, de sorte que le tableau révèle une parfaite cohérence.


Un talent de coloriste
Nicolas de Staël fait entrer la couleur avec fracas , avec remous sans initier de transition vers l’objet de sa peinture. La superposition des couleurs ainsi que l’empâtement créent une rythmique, provoquent une distorsion dans la perception . Les couleurs explosent sans que jamais ces dernieres ne se heurtent les unes aux autres. Seul, un état de tension entre plusieurs blocs rend la toile saisissante. Dans Lettre à Pierre Lecuire, le peintre en route vers l’abstraction donne à son art une définition très parlante : » L’espace pictural est un mur, mais tous les oiseaux du monde y volent librement, à toutes profondeurs ». Et c’est bien le sujet de la profondeur qui intéresse ici. La représentation d’un espace organisé fait apparaître sous des couches de couleur-forme, les couleur du fond, dans une suggestion de la profondeur comme ouverte à tous les sens. Le tableau concentre une infinité d’émotions , et donc une impression d’immensité laissée en l’état. Tout peut se concentrer dans la chose a minima. C’est sans doute ce qu’il entend par : « N’évaluez jamais l’espace trop rapidement. Il y a des petites pommes de pin toutes ratatinées dont l’odeur nous donne une telle impression d’immensité, alors qu’on se promène à Fontainebleau en étouffant dans cette forêt exactement comme en mansarde à nains ». Les sens exaltés renvoient pour moi à la fameuse madeleine de Proust ou aux correspondances chères à Baudelaire. Nicolas de Staël entretient un rapport de sculpteur avec la couleur.

» La pâte nous semble le schème du matérialisme vraiment intime où la forme est évincée, effacée, dissoute. La pâte pose donc les problèmes du matérialisme sous des formes élémentaires puisqu’elle débarrasse notre intuition du souci des formes. La pâte donne une expérience première de la matière «
Utilisée en épaisseur, la peinture à l’huile est une matière modelable qui glisse et garde une certaine souplesse. Le peintre peut ainsi entasser des couches opaques ou au contraire les amincir pour les rendre opalescentes et même transparentes.
Il faut noter qu’à partir de 1953, le peintre revient à la fluidité du pinceau, à la dilution de l’huile étalée au coton ou à la gaze et la matière s’amenuise jusqu’à devenir impalpable.
Elle se dissout. L’atmosphère est onirique et les lignes s’estompent dans les profondeurs presque vaporeuses de la toile.
Epiderme et derme mêlés.
La réussite du peintre réside sans doute dans la capacité à nous faire percevoir l’en-deçà de la toile finie dans cette dernière. L’enduit est dense et subtil sur lequel se mêle un écheveau de traits à la couleur subtile.

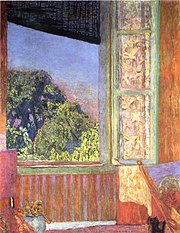
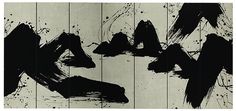


Commentaires récents