
Yoga d’Emmanuel Carrère est un récit dont le fil conducteur n’est pas strictement apparent malgré la chronologie sur lequel il repose. Il y est question de méditation, de yoga, de taï chi et autres pratiques corporelles qui élèvent l’âme indépendamment de l’activité gymnique à laquelle on les réduit parfois. Plus tard, l’auteur envisage le terrorisme, le trouble bipolaire dont il est victime et qui le conduit à de profonds états dépressifs. Plus tard encore dans le livre, le sort des migrants mineurs est abordé frontalement au travers d’expériences de vie qui se croisent et se mêlent autour d’un même objectif- se soustraire à la souffrance sous toutes ses formes, donner sens à ce qui advient. Les bénévoles ne sont pas plus en avance sur cette voie que les jeunes Syriens eux-mêmes, livrés à la Vie sans autre bagage que leur sourire et pour certains une connexion internet.
Le livre qu’on referme avec le désir de le faire durer, parle de tout cela et tout cela fait sens puisque l’auteur s’emploie à tisser les correspondances subtiles entre la recherche de l’unité par la pratique du Yoga et celle de sa dissolution dans la dépression. De sa sortie de crise, il s’achemine vers l’en-dehors que justifie l’expérience de Lesbos.
Un ouvrage au cœur d’une polémique
Ce récit autobiographique connaît un rare engouement et certains considèrent que c’est là le plus beau texte de l’auteur. D’autres au contraire n’y voient qu’une exégèse psychologique sans lien avec ce qu’on conçoit comme œuvre littéraire – laquelle construit la réalité au-delà des faits énoncés.
Certes, le livre peut apparaître comme un exposé de sensations immédiates et non retravaillées par la mise en forme d’une narration a posteriori. Mais il y gagne une intensité dans le caractère abrupt précisément de ce qui s’y dit. La souffrance, l’amour sont des sujets dont la littérature apprécie de s’emparer pour y livrer une vision du monde homogène. L’écriture par fragment a pourtant par ailleurs été largement usitée dans la littérature du XX° siècle, laissant au lecteur la tâche parfois difficile de relier les impressions au-delà de leur hétérogénéité. C’est dire qu’Emmanuel Carrère n’innove pas. Les faits dont il est ici question sont donnés sans éclairage aucun. L’auteur n’extrait rien de ce qu’il énonce mais en privilégiant l’écriture de la sensation immédiate ou celle des faits, il dote son lecteur d’une liberté interprétative. En se disant tel quel, l’écrivain invite à se soustraire à nos propres désordres de l’âme pour y voir notre condition de femmes et d’hommes. L’intime dit ici quelque chose de l’universalité humaine. Le style simple peut apparaître trop simple mais il est le vecteur d’une lecture fluide sans retour, facilitée par la sincérité des propos tenus.


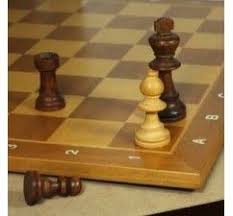


Commentaires récents